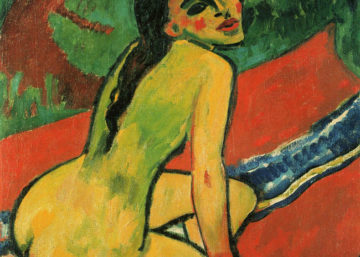Ce matin, mon amie J. m’a laissé un message vocal. C’est rare que ça arrive les messages vocaux. On s’écrit plus qu’on se parle on dirait. J. s’envole vers la Colombie en janvier avec son copain. Elle vient un peu de là elle aussi. Moi c’est mon père, elle c’est sa mère. C’est comme ça qu’on a connecté au Cégep. Dans la région d’où je viens, mon père était le seul immigrant ou presque. Je n’étais pas habituée à rencontrer d’autres mi-Colombiennes, ça m’a fait tout drôle de ne pas me sentir toute seule dans ma gang. J. s’apprête à présenter son deuxième pays à l’homme de sa vie. C’est un beau rituel de faire ça avec quelqu’un. C’est lui donner accès à ce qui nous forme en totalité, à cette multitude de petites nuances qui se dévoilent seulement quand on a un pied dans l’autre monde.
Il y a quelques semaines, en parlant de nos parents, on se disait que ce n’était pas si facile d’aller poser ses racines ailleurs. Une fois que le voile de la nouveauté se dissipe, on s’ennuie de notre pays d’origine, on s’ennuie de la facilité à se faire comprendre à tous les niveaux. À partir de là, on compromet tout ce qu’on est. Quand tu as des racines dans deux endroits à la fois dès le départ, c’est un sentiment qui revient même quand tu es dans le pays où tu es née. Il est difficile de ne pas se sentir déchirés entre les deux mondes de temps à autre.
Ce n’est pas un déchirement qui fait pleurer ni qui fait mal. Il fait même du bien parfois parce qu’il nous rapproche du monde. C’est un déchirement avec lequel tu apprends à vivre, qui fait partie de toi. C’est une identité construite autour de deux pôles qu’il faut balancer. Tout se passe entre les deux. Tu es un entre-deux. J’imagine qu’il y a toujours un côté qui se définit plus que l’autre, qui se construit plus facilement. Probablement celui du pays où tu grandis. Mais ce n’est jamais complet, il y a toujours des manques, des incompréhensions profondes ou superficielles, ici et là. Pour nos parents, c’était autre chose, ils étaient déjà bâtis quand ils sont arrivés, ce qui rend la tâche de s’oublier plus difficile. Parce que c’est sûrement ça qu’il faut faire, s’oublier, quand on arrive dans un endroit qui ne nous est pas cohérent.
Sur son message, J. me disait qu’elle avait envie de lire un livre sur la Colombie, mais pas un livre d’histoire. Un livre qui se passe là-bas du point de vue d’une personne d’ici, mais pas complètement non plus, pas un livre ou un touriste raconte son voyage. Et puis, elle s’est rappelé que c’est ce que je suis en train d’essayer de faire.
C’est pour ça que je fais ce que je fais en ce moment, pour ça que je suis en train d’étudier la littérature. Je veux mettre des mots sur les manques, mais ironiquement je manque de mots pour le faire. Je veux illustrer l’entre-deux mondes sans le nommer de manière à ce qu’il soit aussi implicite et invisible que dans la vraie vie. Il n’y a qu’à travers une histoire que je peux faire ça.
Bien franchement, si ce n’était pas de la mort de mon père je n’aurais probablement jamais éprouvé ce besoin si fort de mettre des mots sur cet entre-deux mondes. C’est à sa mort que le concept a réellement pris forme dans ma tête. Avant, c’était quelque chose d’encore plus flou et je n’y accordais que très peu d’importance. J’étais moi et c’est tout. Une fille avec un nom qui doit être répété trois fois pour être bien écrit, mais qui, à cause de son accent québécois et de sa peau blanche, arrivait à avoir le
« meilleur » de ses deux mondes. Maintenant, c’est différent. Quand quelque chose d’aussi violent arrive, un drame qui n’est pas fait pour le monde dans lequel on évolue, l’autre univers se déverse d’un coup et nous avale comme un raz-de-marée. Maintenant, je me comprends mieux dans l’entre-deux que lorsque j’essaie de choisir de quel côté me placer.
Le fait est que je n’y vis pas seule. Nombreux sont ceux qui s’y retrouvent ; je commence à m’en rendre compte quand j’en parle aux autres. Ce sont surtout des enfants d’immigrants, des deuxièmes générations. Des gens qui ne sont pas déracinés, mais qui ont vu de près ce que ça fait de l’être. Encore là, ce n’est pas toujours le cas. Chacun vit sa différence à sa manière, visible ou pas.
Elle a terminé en disant : « je voulais juste te dire qu’il y a un besoin pour ce que tu fais en ce moment. Il y en a un parce que ce matin je l’ai ressenti ». Ça fait du bien de me faire dire que je ne suis pas la seule à me sentir comme ça, comme une fille qui manque de mots, un peu déchirée sur les bords, mais pas assez pour en faire un cas.
Je souhaite ardemment croire qu’aussi égoïste puisse-t-être ma motivation à écrire, ce qui finira un jour par sortir résonnera chez certain.es. Si je n’arrive pas un jour à exprimer des choses qui me dépassent, je n’ai pas de raison d’écrire.
En ce début de 2020, j’ai quelques textes dans la manche qui abordent ce thème pour lequel je manque encore de mots justes. Je n’ai pas envie d’embarquer dans le festival de célébration des différences pour autant bien que je sois contente qu’il y ait ce genre de mouvement. Je n’écris pas dans le but de militer ou de faire passer un message immensément plus grand que moi. Show it don’t say it, qu’on m’a dit. Je vais expérimenter. Ça sert à ça aussi un blogue. Écrivez-moi vos avis, vos appréciations (ou non), soulignez mes omissions s’il y a lieu. J’ai envie de pousser ma réflexion plus loin.